Khâgne Parcours 1, séance 1 : Composition française : sujet de 2016
Par Bénédicte Hoarau-Beaumin le 04/09/2024, 11h07 - Khâgne Français - Lien permanent

Voici quelques éléments de contextualisation du sujet de Michel Foucault ainsi que le plan détaillé.
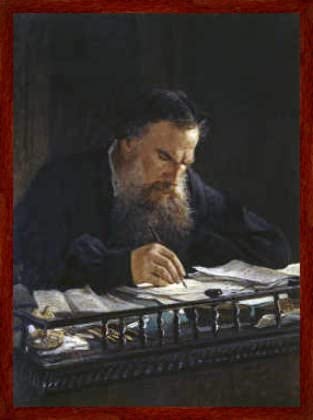
Léon Tostoï par Ilia Repine.
2016 : Michel Foucault commente en ces termes sa conception de la littérature en 1975 : « La littérature ne réside pas dans la perfection du message ; elle ne se loge pas dans l’adéquation du bien dit ; elle est du côté du mal dire – du trop ou du trop peu, de la lacune et de la redondance, du trop tôt ou du trop tard, du double sens et du contretemps. La littérature la plus pure se fraye son chemin dans l’opacité de ces glissements, de ces brouillages qui esquivent l’efficacité du message. » Texte inédit rédigé pour présenter la chaire qu’occupera Roland Barthes au Collège de France, cité par Carlo Ossola, in « Leçon de la ‘‘leçon’’ », Roland Barthes au Collège de France, IMEC, 2002, p. 20.
Vous direz en quoi ce propos éclaire votre vision de la littérature, sans vous cantonner à un genre littéraire particulier.
- Quelques références :
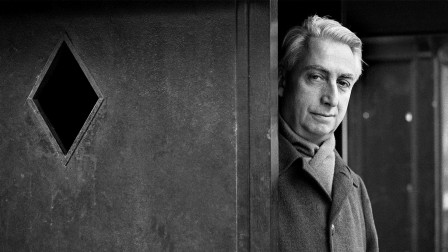
Roland Barthes (1915-1980) est un philosophe, critique littéraire et sémiologue français.
Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et professeur au Collège de France, il est l'un des principaux animateurs du post-structuralisme et de la sémiologie linguistique et photographique en France.
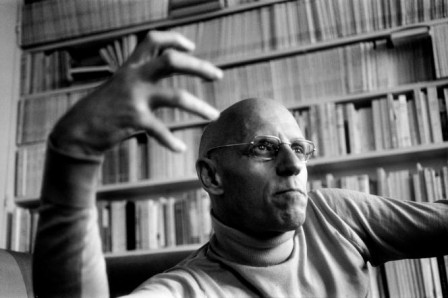
Michel Foucault (1926-1984) est un philosophe français.
Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales sur le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.
- Une copie rédigée :
- Une réflexion sur le concours : La Confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin, Allary édition, 2018
« Mes élèves acquièrent des compétences: ils maîtrisent certaines notions du programme. Quand approche le bac, ils tremblent parfois en énumérant les thèmes non traités. Ils me demandent des cours ou des fiches sur les notions manquantes. Je les invite alors à revoir celles qu'ils maîtrisent déjà. À relire les cours qu'ils ont aimés. À retrouver du plaisir, le meilleur allié de la confiance. En un mot, à se ressourcer dans leur zone de confort. Et ensuite, mais ensuite seulement, à découvrir de nouvelles notions. Je les invite à danser cette valse à deux temps.
Je leur propose aussi de s'entraîner à rédiger des introductions ou des dissertations. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron», dit un proverbe médiéval. Même Héphaïstos, le dieu des forgerons, ne l'est pas devenu en un jour. Jeté à la mer à la naissance par ses parents en raison de sa laideur, il a été recueilli par des nymphes qui l'ont élevé et lui ont enseigné, des années durant, l'art de la forge. Héphaïstos, le dieu des forges, a eu largement ses 10000 heures de pratique ! Je leur demande donc de s'entraîner tout en les mettant en garde contre une logique de stricte compétence : le sujet qui tombera au bac risque fort de ne ressembler à aucun autre. La difficulté du métier de professeur loge dans ce paradoxe : enseigner des compétences en même temps que la méfiance à l'égard des seules compétences.
Les élèves qui s'entraînent la peur au ventre, soucieux d'être préparés à tous les types de sujets, ne réussiront jamais à se faire vraiment confiance. Ils développeront des compétences qui leur apporteront quelques réussites scolaires, mais ils continueront à manquer de confiance en eux et trébucheront un jour ou l'autre. Ils seront plus sujets que d'autres à paniquer, le jour du bac philo, devant une question inattendue. Ils font trop confiance à leurs compétences, pas assez à eux-mêmes.
À l'inverse, d'autres élèves s'entraînent dans un esprit de découverte, moins scolairement. Ils n'ont pas l'obsession de la préparation parfaite mais ont envie de tenter des choses, de relever des défis. Ils ne cherchent pas à se rassurer à tout prix. Ils se tournent vers la pratique en prenant du plaisir, en étant créatifs.
Ils n'ont pas la même manière d'évoquer les sujets que les premiers : dans leur voix, l'excitation, la curiosité rendent leur inquiétude moins vive. Le résultat est frappant. Alors que les autres élèves sont effrayés par l'aléa propre à tout examen, eux semblent s'en amuser. Ils sont prêts à faire avec. Ils comprennent qu'il est le propre d'une vie humaine.
La confiance n'est pas la réassurance. Se faire confiance, c'est se savoir capable d'accueillir l’aléa, non s'illusionner en se persuadant que la vie est prévisible. Bien sûr, il est des situations où le degré de compétence réduit effectivement cet aléa à zéro, mais alors il n'y a pas besoin de se faire confiance : la compétence suffit.
Dans son essai Oser faire confiance, le philosophe Emmanuel Delessert pointe la différence entre la confiance et la compétence: « Se faire confiance, ce n'est pas se dire que l'on peut faire une chose parce qu'on l'a déjà réussie mille fois - quelle tristesse ! Quel manque de perspective! Au contraire, c'est s'adresser à cette part incertaine en soi - jamais activée encore - et décider de l'inviter, de la réveiller.»
Se faire confiance, c'est entreprendre quelque chose que nous n'avons pas « réussi mille fois», que nous n'avons peut-être même jamais tenté. Lorsque nous réussissons, ce n'est plus simplement à notre compétence que nous faisons confiance : c'est à nous-mêmes. »
« N'hésitons pas à fêter nos réussites, si petites soient-elles : elles sont autant d'étapes sur le chemin de la pleine confiance en soi. Nous le sentons d'ailleurs lorsque nous félicitons nos enfants : nous les invitons chaque fois un peu plus à prendre confiance en eux.
Nous avons eu confiance en notre capacité à mettre un pied devant l'autre, à écrire « en attaché », à faire du vélo... Nous avons confiance en notre capacité à déchiffrer une partition, à nous repérer dans une ville étrangère, à engager la conversation, à exprimer notre désaccord, à formuler nos désirs, à prendre la parole en public...
Et puis un jour, nous avons confiance en nous.
C'est ce que j'appellerais le saut de la confiance en soi. Toutes ces pratiques sont autant de chemins qui conduisent à ce saut, le rendent possible, autant d'occasions de vivre cette métamorphose. Inutile, d'ailleurs, de vouloir la précipiter : ce n'est pas en cherchant avec insistance plus de confiance en soi que nous l'obtien-drons. Il faut faire ses gammes avec patience, avec curiosite aussi. Et puis un jour, sans même parfois s'en rendre compte, commencer à improviser. »